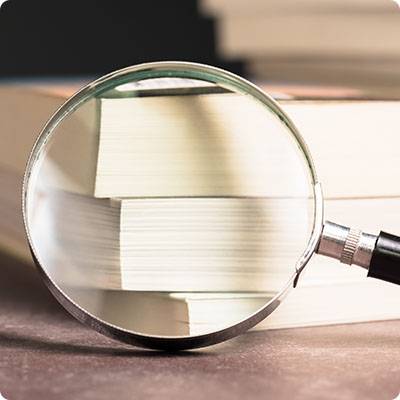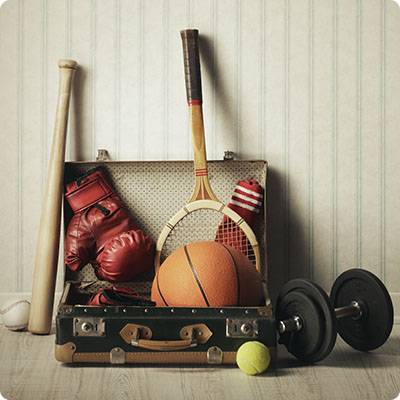3350 av. J.-C
La présence ancienne d’humains en Italie est attestée par des découvertes archéologiques, notamment dans les Alpes italiennes, qui nous intéressent ici. On pense en particulier à celle d’Ötzi, dans le Sud-Tyrol, datant du IVe millénaire avant notre ère : un homme de glace découvert en 1991 dans les Dolomites, près de la frontière autrichienne, du Chalcolithique. Naturellement momifié (congelé et déshydraté), à 3210 mètres d’altitude, son existence a été révélée par la fonte importante du glacier, en été. Il est actuellement exposé au musée archéologique de Bolzano.
800 av. J.-C
Les choses sérieuses commencent lorsque des hordes d’envahisseurs traversent les cols alpins. A l’âge de fer, les peuples italiques sont les Ligures, les Rhètes, les Vénètes et les Etrusques. L’invasion la plus marquante est celle des Etrusques, vers 800 av. J.-C. Absorbant les coutumes autochtones, ils donnent naissance à une culture originale, qui s’étend du Latium jusqu’en Ombrie et à Venise. Au VIIe siècle av. J.-C., ils connaissent une belle prospérité économique et exportent des objets de bronze et des céramiques en Méditerranée. Mais ils se heurtent souvent aux Grecs et aux Carthaginois. Ils ont influencé les Romains dans les arts et la divination. Le musée archéologique de Turin expose des vestiges étrusques de la région.
200 av. J.-C
Tandis qu’au sud les cités étrusques perdent leur indépendance face à Rome, au nord les incursions des Celtes détruisent les villes de la plaine du Pô. La conquête romaine de la région durera un siècle. Ce sont surtout les Carthaginois qui leur donnent du fil à retordre. Lors de la deuxième guerre punique, Hannibal traverse les Alpes à dos d’éléphant. Mais il n’arrive pas à prendre Rome et bat en retraite. C’est le début de l’hégémonie romaine. Le musée archéologique de Pordenone expose des vestiges de la romanisation dans les Dolomites frioulanes.
568
Les papes qui se succèdent à la tête du Saint-Siège vont apparaître comme les seuls défenseurs des intérêts des Italiens, abandonnés à leur sort par l’empereur byzantin. A la fin du VIe siècle, les Lombards (ou plus exactement les Langobards) envahissent le nord de l’Italie et, très vite, occupent la vallée du Pô. Ils créent alors dans la région des duchés dont ceux du Frioul, Ceneda, Trévise, Trente, Milan, Bergame, San Giulio, Turin... Des céramiques lombardes sont exposées au musée archéologique de Milan. Face à la menace lombarde, Rome demande l’aide des Francs, au moment de leur incursion en Europe.
774
C’est alors que Charlemagne, roi des Francs, devient le véritable maître de la péninsule, annexant le nord de l’Italie à son empire, à l’exception de Venise. Le duché lombard de Bénévent reste indépendant et l’Empire byzantin continue de régner sur l’Italie du Sud, en Calabre et en Sicile. La division nord/sud de l’Italie date de cette époque. Avec le déclin de l’Empire carolingien commence pour l’Italie une longue période de troubles, marquée par les luttes entre potentats pour le titre de roi d’Italie et les ravages causés par les incursions sarrasines. La papauté elle-même n’est pas épargnée et tombe aux mains de familles aristocratiques.
951
Le roi de Germanie envahit le nord de la péninsule et s’approprie l’Italie et se fait couronner empereur (962). C’est un moment de relative stabilité en Italie. La domination des empereurs germaniques s’installe pour trois siècles, se heurtant sans cesse aux velléités d’indépendance des nobles familles romaines et grands féodaux, tel le duc lombard Pandolfe Tête-de-Fer. Pour contrer leurs appétits d’émancipation, les empereurs doivent soutenir l’essor des villes, devenues florissantes au cours du XIe siècle grâce au commerce et qui s’émancipent justement des seigneurs féodaux auxquels elles appartiennent (évêques, archevêques, capitani, etc.). C’est le cas de Venise, affranchie de toute vassalité, qui continue de commercer avec l’Orient byzantin, ainsi que Gênes et Pavie.
XIIe siècle
La lutte qui oppose empereurs germaniques et papauté connaît une nouvelle phase avec la dynastie des Hohenstaufen. Le premier, Frédéric Ier Barberousse, s’attache à rétablir l’autorité impériale. Il s’oppose à l’Eglise ainsi qu’aux villes lombardes désormais affranchies de tout pouvoir, qui infligent à l’empereur une cuisante défaite lors de la bataille de Legnano, en 1176. Malgré cela, les villes lombardes doivent se résoudre de nouveau à subir le joug impérial. Le dernier Hohenstaufen, Conradin, est vaincu en 1268, sonnant le glas de la domination germanique sur l’Italie.
XIIIe siècle
Les Germains partis, les luttes intestines se poursuivent en Lombardie, extrêmement ruineuses pour les vieilles familles marchandes au pouvoir. Milan tombe entre les mains des Visconti, Vérone entre celles des Scaligeri... Instaurant des régimes tyranniques, ils rétablissent l’ordre et la prospérité. La plupart sont aussi de grands mécènes. Dans le nord de l’Italie, trois grandes cités dominent le paysage politique et économique : Milan (mais en 1450, les Visconti sont chassés par les Sforza), Venise, république oligarchique et puissance maritime (qui voit son hégémonie remise en cause en 1453 par la prise de Constantinople par les Turcs) et Florence qui, sur le plan des lettres et des arts, est un foyer culturel et spirituel d’Europe.
1494
Charles VIII, accueilli favorablement à Milan où il aide à renverser les Sforza, puis à Florence où les Médicis connaissent le même sort, s’empare de Naples en 1495. Mais il doit renoncer à l’occuper durablement devant la menace des forces italiennes coalisées du pape Alexandre VI de Venise et de Ludovic Sforza, à nouveau duc de Milan. Pendant la reconquête du pouvoir par le Saint-Siège, la Lombardie sera, au début du XVIe siècle, le théâtre de sanglantes batailles.
1529
A un Valois succède un autre Valois en la personne de François Ier, qui reprend les guerres italiennes sitôt son avènement. La célèbre bataille de Marignan (1515), où les Français remportent la victoire avec les Vénitiens face aux Milanais et aux Suisses, sera contrée par le désastre de Pavie (1525), une bataille contre les Aragonais, mais aussi contre les troupes impériales de Charles Quint, pendant laquelle François Ier est fait prisonnier. Libéré un an après contre rançon, reprenant dans la foulée les armes, le roi de France accepte de traiter avec Charles Quint en abandonnant l’Italie à l’Empire des Habsbourg par le traité de Cambrai, en 1529.
1559
A partir de cette date, elle est totale dans le nord de la péninsule, écrasant les dernières velléités d’opposition des cités lombardes et toscanes, rétablissant les Médicis à la tête de Florence. En 1559, par le traité de Cateau-Cambrésis, le royaume de France abandonne définitivement la péninsule italienne à la domination des Habsbourg, qui se poursuivra jusqu’en 1792. Deux entités politiques et économiques réussissent malgré tout à garder une certaine indépendance : la Savoie qui, dès 1562, installe sa capitale à Turin, et Venise, dont les possessions et la puissance économique et commerciale sont mises à mal, malgré la victoire de Lépante (1571), par l’avance inexorable des Turcs.
XVIIe et XVIIIe siècles
Ces siècles apportent à l’Italie de nouvelles destructions lors des grandes guerres européennes qui opposent la France des Bourbons à l’Espagne des Habsbourg. A la mort de Charles II d’Espagne, dernier représentant de la dynastie espagnole, le nord de la péninsule souffre des guerres de succession des Habsbourg. La paix signée lors du traité d’Utrecht de 1713 donne le trône d’Espagne à Philippe V, petit-fils de Louis XIV, substituant l’hégémonie espagnole par celle des Autrichiens, mais surtout renforce le pouvoir de la Savoie indépendante qui obtient, en 1720, la Sardaigne. Entre 1734 et 1738, puis entre 1741 et 1748, deux guerres de succession embrasent une nouvelle fois le nord du pays.
1748
Ce traité met fin aux hostilités et fixe les divisions politiques de l’Italie : les Etats pontificaux coupent toujours la péninsule en deux, tandis que la Savoie renforce ses positions dans le Piémont et en Sardaigne. Cette même Savoie qui, au cours du XVIIIe siècle, connaît le despotisme éclairé de ses princes (Victor-Amédée II, suivi de Charles-Emmanuel III), imités par les autres régnants des principautés italiennes. Cependant, malgré ces réformes, un écart croît entre un Nord sensible aux idées philosophiques européennes, et un Sud dominé par de grands propriétaires terriens, chantres de l’immobilisme.
1805
Prenant d’abord la Savoie, les troupes révolutionnaires françaises de Napoléon ne pénètrent en Italie du Nord qu’au printemps 1796. Un an plus tard, la paix est signée à Campo Formio (qui marque la fin de Venise comme Etat) : l’Italie du Nord est organisée en républiques libres, auxquelles viennent se joindre, après leur conquête, les républiques des anciens Etats pontificaux et de l’ancien royaume de Naples. Malgré les exactions guerrières, les Italiens découvrent la liberté. Une « âme italienne » semble être née. Après la proclamation de l’Empire français en 1804, les républiques italiennes sont fédérées dans le « royaume d’Italie » en 1805 par Napoléon. Viennent s’ajouter, entre 1805 et 1809, la Vénétie et le Trentin. Si l’empereur n’a jamais eu la volonté d’unifier l’Italie, elle se réalise de fait : le code de lois Napoléon régit la vie citoyenne à l’origine du futur Risorgimento de Garibaldi, le “père de la Nation”. Mais l’expérience « unitaire » prend fin avec le réveil des ennemis européens de l’empereur.
1813
En octobre 1815, toute la péninsule est conquise par les troupes de l’empire d’Autriche (hérité de la dynastie des Habsbourg). C’est un retour aux régimes despotiques. Les princes italiens retrouvent leurs duchés, l’Autriche recouvre la Lombardie, les Etats pontificaux et le Piémont sont restaurés. La répression s’abat sur le peuple. Une conscience nationale se développe, relayée par les sociétés secrètes, les fameux carbonari, constituées d’intellectuels, d’officiers, de magistrats... Ces actions sont réprimées, comme les soulèvements de 1820 dans le Piémont. L’idée d’une unité nationale fait son chemin, mais trois courants s’affrontent. Le premier prône une confédération des principautés italiennes dirigée par le pape ; le deuxième milite pour une République unitaire ; le troisième rêve aussi d’une fédération, mais chapeautée par le royaume du Piémont. C’est cette dernière mouvance qui l’emporte en 1860.
1848
Suite aux révoltes populaires, le roi du Piémont Charles-Albert doit, sous la pression, instaurer dans son royaume un régime constitutionnel. Parallèlement, la Lombardie se soulève contre l’occupant autrichien, rejoint par le roi de Piémont qui déclare « l’Italia farà da se » (« l’Italie se fera elle-même »). S’ajoutent des renforts envoyés par d’autres princes italiens et même par la papauté. Mais, très vite, les dissensions puis la défection du pape laissent seul Charles-Albert de Savoie aux prises avec les Autrichiens, et, en août 1848, il signer un armistice. Ayant sauvé l’essentiel, Charles-Albert reprend le combat en 1849 mais, une nouvelle fois battu, il abdique en faveur de son fils Victor-Emmanuel II.
1820 – 1878
Laissé seul face aux régimes absolutistes italiens soutenus par l’Autriche, le royaume du Piémont voit arriver, en 1852, à la tête de ses affaires, un dénommé Cavour, dont l’habileté diplomatique va conduire à l’unité de l’Italie sous l’égide de Victor-Emmanuel II. Par le traité de Turin en 1860, la Savoie et Nice reviennent à la France de Napoléon III, qui accorde en échange son aide militaire au Piémont contre l’Autriche. La guerre, marquée par les batailles de Magenta (4 juin 1859) et de Solférino (24 juin), est victorieuse. Le Piémont récupère la Lombardie, mais pas la Vénétie, qui reste aux mains des Autrichiens. Les troupes piémontaises envahissent les Etats pontificaux puis imposent l’autorité du roi à Naples. Victor-Emmanuel II est proclamé roi du Piémont en 1861 par, ce qui est nouveau, « la volonté de la nation », soit le peuple italien tout entier. Florence devient la capitale du jeune Etat italien, Rome étant toujours occupée par le pape et les forces françaises chargées de le protéger.
1870
Ce n’est qu’en 1870, à la suite du retrait des troupes de Napoléon III – guerre franco-prussienne oblige –, que Rome est enfin réunie à la nation et devient capitale. Le musée du Risorgimento à Milan résume l’unification italienne, de la campagne d’Italie de Napoléon à la nation italienne, grâce aux actions conjointes de Garibaldi, Victor-Emmanuel II, Cavour et Mazzini, considérés comme « les pères de la patrie ». L’unité du pays enfin réalisée, l’Italie prend conscience de son retard économique à l’échelle de l’Europe, de ses différences de développement entre le nord industriel du Mezzogiorno et le sud presque exclusivement rural. La population pauvre du sud est poussée à l’émigration, principalement vers le Nouveau Monde. C’est aussi l’époque de l’expansion du colonialisme italien. Sur le plan politique, la monarchie parlementaire est fragile, du fait du régime censitaire en vigueur. Ce n’est qu’en 1912 que le suffrage universel finit par s’imposer.
1914 - 1918
Rattachées à l’Empire austro-hongrois lorsque débute le conflit, les Dolomites italiennes sont douloureusement marquées par la Grande Guerre puisque leurs crêtes constituent la ligne de front. L’Italie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie (mai 1915), puis à l’Allemagne (août 1916). Entre 1915 et 1918, Italiens et Autrichiens s’y affrontent dans des combats d’une incroyable barbarie. Les militaires des deux camps creusent des tranchées, équipent les parois abruptes pour s’y déplacer, évident montagnes et glaciers pour créer galeries, dortoirs, entrepôts d’armes et de munitions, hôpitaux… La randonnée en ski alpin First World War Tour permet d’en apprécier les vestiges dans les Dolomites. Par le traité de Saint-Germain établissant la paix entre les Alliés et l’Autriche, l’Italie acquiert le Trentin et Trieste.
1922
En 1919, Mussolini fonde à Milan les Faisceaux italiens de combat. Les troubles sociaux, la violence, les carences évidentes du régime parlementaire, l’instabilité gouvernementale profitent au fascisme et à Mussolini qui, le 28 octobre 1922, organise avec ses Chemises noires la fameuse marche sur Rome. Le 30 octobre, le roi Victor-Emmanuel III appelle le Duce au pouvoir. Respectant tout d’abord le régime parlementaire, Mussolini organise des élections en 1924 qui renforcent sa suprématie. La dictature fasciste commence alors, et sa politique extérieure se radicalise brutalement après la conquête de l’Ethiopie, entreprise fin 1935.
1939-1945
Quand Hitler, en 1939, se trouve isolé face à l’Angleterre et la France, Mussolini ne le suit pas. Mais en juin 1940, quand les Alliés sont défaits par les Allemands, l’Italie entre en guerre et envahit la France. Mais l’armée, mal préparée, va de défaite en défaite et la contestation populaire gagne les rangs du parti fasciste, le Grand Conseil. En juillet 1943, celui-ci destitue et arrête Mussolini. Un nouveau gouvernement négocie un armistice avec les Alliés. Avertie, l’Allemagne envoie ses troupes occuper Rome et l’Italie du Nord. Une fois libéré, Mussolini, avec l’aide des nazis, reconstitue un Etat fasciste au nord : la république de Salo. De nouveau arrêté en 1945, alors que les Alliés avancent et qu’Hitler est esseulé, Mussolini est cette fois sommairement exécuté avec son amante, leurs dépouilles pendues par les pieds offertes en pâture à l’ire populaire sur une place de Milan. L’Italie vaincue perd ses possessions coloniales, ainsi que celles de la Première Guerre mondiale, c’est-à-dire Fiume, l’Istrie, la ville de Zara et une partie de la Vénétie Julienne, qui passent aux mains des Yougoslaves.
1948
La paix revenue, le Comité de libération nationale organise des élections et un référendum qui va condamner la monarchie. Humbert II, sur le trône depuis l’abdication de son père Victor-Emmanuel III, choisit de s’exiler. La nouvelle constitution, entérinée en 1948, laisse une grande influence au président du Conseil, chef du gouvernement et véritable détenteur du pouvoir exécutif. La vie politique est marquée par la lutte pour le pouvoir entre quelques grands partis issus de la Résistance, comme le Parti communiste (PCI), le Parti socialiste (PSI), le Parti républicain (PRI), les Sociaux-démocrates et enfin la Démocratie chrétienne (DC). Cette dernière bénéficie d’un large écho auprès des Italiens, et va être présente dans les trente-deux gouvernements qui vont se succéder à la tête de l’Italie entre 1946 et 1974. Mais la vie politique est caractérisée par des crises incessantes.
1970
A l’Autunno Caldo (« l’automne chaud ») de 1969, l’Italie doit faire face à des grèves, manifestations, émeutes et à un activisme violent et incontrôlable, notamment des Brigades rouges et des groupuscules de droite. Le Premier ministre Aldo Moro est enlevé en 1978 par les Brigades rouges, puis tué à la suite du refus du gouvernement de négocier. Après de nombreux efforts, vers 1985, vitalité de l’économie italienne aidant, le terrorisme est quasiment éradiqué. Mais l’Italie se trouve confrontée à une série de scandales qui révèlent l’ampleur de la corruption qui ronge le pays et de la mainmise de la mafia sur sa vie économique et politique. L’opération Mani Pulite (« mains propres ») en 1992 a pour but d’assainir la vie politique et publique.
1992
Elu président du Conseil en 1996 et 2001, le milliardaire magnat des médias Silvio Berlusconi doit faire face à une hostilité grandissante qui atteint son apogée en 2005, lorsque 12 régions sur 16 sont gagnées par le Parti Démocrate du centre-gauche. En 2006, le leader de ce parti, Romano Prodi, devient le chef du Conseil italien. En difficulté à droite, le Cavaliere crée le parti du Peuple de la Liberté (PDL), revient en force et remporte haut la main les élections législatives en 2008. Toutefois, la crise internationale, les scandales de corruption, de détournement de fonds et de prostitution de mineures (le Rubygate) l’affaiblissent. Les élections municipales de 2011, qui marquent la perte de Naples et surtout de Milan, fief historique du Cavaliere, le poussent à démissionner en novembre.
2011
Un nouveau gouvernement de technocrates dirigé par l’ancien commissaire européen Mario Monti est investi par le Parlement, avec pour objectif la restriction budgétaire pour sauver l’économie. Mais les élections législatives de 2013 entérinent la victoire de la coalition centre-gauche du Parti Démocrate (29,5 %), talonnée par le centre-droit (29,1 %), loin devant Mario Monti (10,5 %). Le dégagement d’une majorité au gouvernement semble difficile. Une crise politique s’amorce jusqu’à l’entrée en politique de Matteo Renzi, premier secrétaire du P. D. En 2016, les Italiens rejettent à 60 %, par référendum, la réforme constitutionnelle portée par Renzi, qui rend son tablier. Le chef du gouvernement s’appelle alors Paolo Gentiloni, mais les élections de 2018 vont rebattre les cartes.
2018
En 2018 les élections législatives et parlementaires placent au pouvoir une coalition menée par Matteo Salvini (37 % des voix), de la Ligue du Nord (parti d’extrême droite), associé à Forza Italia, l’ancien parti de Berlusconi. Leurs idées : nationalisme, conservatisme, racisme, euroscepticisme. Le second est le Mouvement 5 étoiles (M5S), mené par Luigi di Maio, parti populiste “antisystème”, également eurosceptique. Le grand perdant est la coalition de Centre-Droit menée par Renzi (22,9 % des voix). A travers ce vote, les crises migratoire et économique, le chômage, un désaveu de la politique européenne ressortent comme les principales préoccupations des Italiens.
Septembre 2019
Le gouvernement de Guiseppe Conte de coalition Ligue du Nord-M5S éclate lorsque Matteo Salvini, leader de l’extrême droite, claque la porte dans le but de provoquer des élections anticipées. Mais le M5S forme, contre toute attente, une coalition avec le PD de centre gauche pour constituer un nouveau gouvernement, plaçant de facto la Ligue du Nord dans l’opposition.
Février 2020
L’épidémie de Covid-19 surgit en Italie du Nord, principalement en Lombardie et en Vénétie, les deux premiers clusters européens, avant de gagner tout le pays et le reste de l’Europe, plongeant le pays dans un long confinement.